Même si mes cheveux disent le contraire, je suis encore jeune… Pourtant j’ai déjà eu de nombreuses occasions de vérifier l’adage de Dr. House : « Tout le monde ment » (Everybody lies).
Comme promis tout à l’heure, je vais vous en faire une illustration pratique avec un top five.
J’éluderai donc les mensonges classiques concernant les addictions inavouées (L’alcool, non, quasiment plus. C’est ça, et moi Twitter j’y passe 10 minutes par jour au grand mot), les patients qui notent « non substituable » eux-mêmes si le pharmacien insiste pour donner le générique (ce qui est son boulot, au passage), les fils de 40 ans attachés au retour (financier) de leur mère ou toute autre histoire où le médecin est l’arbitre d’une famille où chacun y va de ses petits secrets transformant la consultation en partie de Cluedo (je sais que lui sait que elle sait que lui sait, mais pas…)
Allons-y…

En cinquième position, les stupéfiants des sexagénaires…
Quand on parle de mensonge, je repense à cette dame de 60 ans, douce et timide, du genre probablement à rosir au moindre compliment. Et butée comme quelqu’un qui cherche à obtenir trois étoiles à chaque niveau d’Angry Birds.
Depuis 20 ans elle prend 1 comprimé de zolpidem le soir pour dormir. En supposant que cet apparenté de benzodiazépine (responsable d’une surmortalité – j’en reparlerai à l’occasion) ait un jour pu avoir une utilité, en tout cas maintenant c’est juste une drogue addictive (comme la vicodine → je m’adapte aux nouveaux lecteurs attirés par Dr. House).
Comme je suis globalement contre la drogue après 60 ans, je lui propose d’essayer de baisser à 1/2 comprimé par jour et de revenir à la fin de la boîte de 14. Elle accepte et revient vingt-huit jours plus tard (victoire !).
Elle a bien pris un demi-comprimé. Une fois. Le lendemain matin elle s’est réveillée, non fatiguée (ah :)), mais trente minutes trop tôt à son goût (oh :(). Du coup dès la deuxième nuit, elle a repris un comprimé entier pour se lever trente minutes plus tard (notez au passage que le zolpidem n’est pas censé agir en fin de nuit, avec une demie-vie de deux heures…)
Et sinon, j’ai suivi une formation en calcul mental à l’école primaire et pour moi, tenir 30 jours à un comprimé par jour avec seulement une boîte de 14, c’est soit à signaler à Lourdes, soit à considérer comme une arnaque. J’expose cette idée en des termes un peu plus polis, et la patiente me répond, le rose aux joues : « Je suis allée en chercher une chez ma belle-soeur ».
Outre le fait qu’elle n’a pas été canonisée pour multiplication d’hypnotiques, on a quand même mis le doigt sur un trafic de stupéfiant chez des sexagénaires. (NB. Si vous êtes un journaliste en mal de sensationnalisme, remplacez benzodiazépine par « drogue du violeur », ça fera chouette.)
En quatrième position, un jeu de dupes médico-judiciaire…
Un jour, un jeune vient pour « un certificat pour faire des tiges ». Évidemment, je lui réponds aussitôt que je suis « d’accord, mais parlez-moi de vous d’abord ». Entre parenthèse, je ne bitte rien à sa demande (bah oui, tout le monde ment, moi compris…) En parlant, je comprends donc qu’il ne s’agit pas de fabriquer des aliments pour panda, mais de Travaux d’Intérêt Général, T.I.G.
Il n’y a pas besoin de certificat normalement, mais là, sûrement inspiré par le dernier épisode des Teletubbies qui prônait l’honnêteté, le patient a déclaré spontanément à la juge qu’il continuait à fumer du cannabis, parce que ça lui plaisait.
Évidemment, maintenant il lui faut un certificat attestant qu’il suit une prise en charge spécifique pour ce problème. Sauf que la première chose qu’il me dit — toujours à cause de Tinky-Winky et ses amis — c’est qu’il ne veut pas arrêter. Bon… Il veut bien venir en parler, si ça suffit pour dire qu’il est pris en charge, mais voilà ça n’ira pas plus loin pour l’instant. Donc on lui fait un certificat (il vient, c’est une prise en charge) qui lui sert à mentir… à cause de son honnêteté !
J’adore cette ironie.
En troisième position, un cliffhanger policier.
C’est l’histoire d’un ancien flic (haut gradé) qui a parlé de suicide à sa femme, qu’il accuse de tromperie. Il est accueilli en psychiatrie pour faire le point sur son désespoir. Il nous explique rapidement que ce n’était pas de vraies menaces, juste des « j’vais m’flinguer » comme tout le monde peut le dit sur le coup de la colère. Oui, il a bien un fusil de chasse à domicile, chargé, et oui il y a peut-être déjà songé, mais pas actuellement. Pour l’heure, il n’en peut surtout plus de l’infidélité de madame – et c’est d’ailleurs elle qui l’adresse, sûrement pour retrouver son amant.
Il est convaincant : c’est un homme droit (voire rigide comme un chêne renforcé au béton armé), avec des principes qui semblent sortis d’un cahier de leçons de morale des années 1960. Il a le cœur brisé par sa femme, qui s’est révélée être de grande légèreté morale, depuis le début de sa retraite.
Bon, évidemment chez un ancien haut gradé de la police, on se dit qu’il y a sûrement une part de paranoïa (cette déformation professionnelle qui permet d’atteindre les hautes sphères), en plus des idées suicidaires et de traits dépressifs. Mais quand même, il nous dit l’avoir espionnée et son histoire de voisin laisse quand même à croire qu’il n’y a pas que du linge dans le placard de madame. Histoire de faire le point dans tout ça, et comme il n’est pas encore autorisé de fouiller le domicile, on se contente d’interroger l’épouse à part… Et contre toute attente, môssieur j’ai-des-principes avait une maîtresse ! Bim. Retournement de situation. Parfait pour l’audimat !
Il avait donc réussi à nous vendre un personnage paranoïaque, psychorigide, presque attachant dans son amour envers une femme qui ne le méritait pas… en omettant les vrais raisons de leur dispute. Chapeau pour la composition, qui méritait un prix dramatique ! (Bon après il a fugué du coup, on se sentait bête d’avoir un paranoïaque mythomane dans la nature avec un fusil chargé à disposition. Mais il a été retrouvé par la police.)
En deuxième position, un patient Congolais Belge de Lyon qu’il faut croire sur parole.
Bon, là on entre dans la catégorie des winners. Finis les petites entourloupes, voici venu le temps des menteurs professionnels.
Les urgences accueillent un patient de vingt ans, d’origine congolaise, drépanocytaire en pleine crise. Aïe, quoi. Ni une, ni deux, ils lancent le traitement pour ce malheureux qui se tord de douleur : hydratation, paracétamol et rapidement morphine, comme l’indique le protocole. C’est un échec, ils doivent passer de la kétamine. Le service d’hématologie est plein, il est transféré ailleurs. Chez nous.
Il est tard quand il arrive dans le service (18 heures environ), je vais l’interroger seul. Il est Congolais, né à Lyon, venu en Belgique pour ses études et de passage à Lille pour chercher un job d’été. L’entretien ne s’est pas très bien passé d’ailleurs, mais bon. Il est drépanocytaire sous HYDREA (hydroxyurée), pour que ses globules malformés aillent mourir ailleurs que dans ses vaisseaux.
L’examen est normal, ainsi que le bilan réalisé aux urgences. Je lui dis que je trouve étonnant de voir sa numération formule sanguine réalisée aux urgences, car il n’y a pas d’anémie et le VGM est normal (la taille des globules rouges est normalement très diminuée dans les drépanocytoses). Du tac au tac, il me répond que c’est une bonne chose, comme ça il peut ne pas prendre son HYDREA pour l’instant. Ok, bon, l’indication et la surveillance d’une chimiothérapie dans une maladie que je croise 2 fois par an, c’est pas forcément mon fort (ni aux urgentistes d’ailleurs). Actuellement, il n’a plus mal et la voie veineuse a sauté ; je lui propose d’en reposer une au cas où on aurait besoin de repasser de la morphine… Il me dit que non, ça va aller, il n’aime pas trop être sous morphine. Au cas où, j’en prescris en sous-cutané pour la nuit « si besoin », et je me fais faxer le protocole de prise en charge du service référent en drépanocytose dans la région (hématologie au CH de Saint-Vincent), qui commence par « Avant tout : toujours croire le patient +++ ».
Le lendemain, je revois le patient qui a dormi comme un bébé, n’a pas pris de morphine ou d’antalgique, et veut rentrer chez lui. Ca se comprend, quand on a une pathologie évoluant par crise comme la drépanocytose, ou autre maladie chronique, on devient sûrement allergique aux hôpitaux… Par un extrême hasard, j’ai un peu de temps, et je m’apprête à dicter son courrier quand je me rends compte qu’il n’a pas donné de nom de médecin traitant. Je vais le voir alors qu’il range ses bagages : il me dit que son père est généraliste sur Lyon, et qu’il suffit de lui envoyer. Je retourne donc voir dans l’annuaire du CHR mais ne le trouve pas… Idem sur les pages jaunes. Je le recroise dans le couloir, en train de partir, et lui demande pourquoi. Il m’explique que son père a un nom plus complet genre « Btawe Mamadou Batave » ou un truc du genre. Je vais chercher, mais ne le trouve pas. Pendant ce temps, le patient est parti. L’urgentiste m’appelle pour prendre des nouvelles car il avait un peu paniqué hier, c’était la première fois qu’il voyait une crise aussi sévère, nécessitant de la kétamine.
Forcément, raconté comme ça dans un article intitulé « tout le monde ment », cette histoire transpire l’arnaque quelque part, mais le gars donne vraiment le change sur tout. J’ai un vague doute sur la NFS, mais je me dis qu’il a sûrement raison (et puis surtout, il n’a pas pris de morphine pendant la nuit, ce qui est curieux pour quelqu’un qui serait toxicomane).
Il revient une semaine plus tard par le même parcours : urgences → oh tiens il est déjà passé dans ce service là, hop retour à l’envoyeur → notre service. Il atterrit cette fois dans les lits de ma co-interne, avec une pompe à morphine qu’il a gardée cette fois. Le lendemain matin, ça va mieux, il sort.
Et l’iPhone du chef de clinique disparait. Ainsi que le portable d’une patiente, pendant sa douche.
S’ensuit une mini-enquête au sein du service… On apprend alors que le patient s’est fait 80 shoots de 1 mg de morphine intra-veineuse pendant la nuit (beau score). Il a raconté à ma co-interne que son père était chef de service de réanimation à Lyon (bah oui, c’est plus pratique au cas où on lui reposerait la question de l’adresse, il s’est adapté à la petite difficulté que je lui avais posée). Ma co-interne se rend compte également que sa NFS est normale, mais il lui a fait le coup de l’HYDREA. Pour vérifier, elle demande un avis au professeur d’hématologie référent du CH d’à-côté qui lui dit : « d’accord je vais vous dire s’il est drépanocytaire, quel est son VGM ? — 92 — Il n’est pas drépanocytaire. » Bon. On demande une électrophorèse de l’hémoglobine pour confirmer, et effectivement il s’était bien fichu de nous.
Pour l’anecdote, l' »enquête » a révélé qu’il y avait également un interne de neurochirurgie d’un hôpital à 10 minutes de là qui venait prendre des nouvelles de patients (!), et s’assurer qu’ils avaient bien de l’eau (!!). Genre, les internes de neurochirurgie passent déjà leur vie à l’hôpital mais en plus ils jouent les aides-soignants des autres services… Il s’est révélé qu’il s’agissait d’un étudiant en médecine ayant fait une bouffée délirante aiguë suite à son échec en première année, qui faisait connaissance dans les halls d’hôpital et venait ensuite leur rendre visite (sans rien voler ou quoi que ce soit) en tant qu’interne.
Non mais quel service de folie ! 😀
En premier, voire hors catégorie…
Le pompon. La cerise sur le gâteau du pompon, même. Une patiente, du même service (décidément), suivie depuis presque vingt ans pour un lupus cutané (it’s not a lupus, bah là si). Elle était sous corticoïdes et sous hydroxychloroquine (PLAQUENIL), un traitement de fond relativement bien toléré – en tout cas, parfaitement pour elle. Puis, les années s’écoulant, elle prit de moins en moins son hydroxychloroquine et commença à refaire des poussées de son lupus (oui, je suis passé au passé simple, je trouve ça plus immersif. C’est la championne, après tout, donc traitement de faveur). Malgré des éruptions sur le visage et les mains complètement invalidantes, la patiente avait des taux sanguins très bas d’hydroxychloroquine (donc elle ne le prenait pas), et utilisait probablement mal (ou pas ?) les dermocorticoïdes, puisque chaque hospitalisation accompagnée de soins locaux suffisait à faire régresser ses symptômes.
Puis, à certains moments de sa vie, au décours de grossesses par exemple, elles reprenaient son traitement de fond et la maladie connaissait une accalmie. Et puis, elle arrêtait et… bref, vous avez compris.
Du fait de son inobservance, et de l’évolution inhérente de son lupus, elle fut incluse dans des protocoles avec des traitement à administration intraveineuse (on était sûr qu’elle le prenait comme ça), en plus de son hydroxychloroquine. Au décours de ces thérapeutiques plus lourdes, elle présenta des complications infectieuses assez importantes… Elle était clouée au lit, en train de perdre 20 kg en 1 mois, avec des sueurs toute la journée et la nuit, des pics de fièvre à 40°C tous les jours, et un bilan biologique qui montrait des signes d’inflammation et un syndrome d’activation macrophagique, entre autres.
Et puis, à force de traitement, de patience, peut-être même un peu de chance, tout ça s’arrangea. Elle commença à se relever, descendre en fauteuil roulant, puis marcher jusqu’à la douche. Au terme de 6 semaines d’hospitalisation, on put même lui enlever les voies veineuses (enfin c’est surtout qu’elles s’étaient surinfectées). Et là, pendant les bolus de corticoïdes (intraveineux), on ne comprit pas pourquoi le potassium restait bas dans le sang, malgré des doses de lasagnes de cheval (12 sachets de DIFFU-K par jour). Pendant une absence de mon co-interne, qui s’en chargeait actuellement (après l’avoir reprise pendant mes vacances), la première hypothèse qui me vint était qu’elle ne les prenait pas, et je me renseignai donc auprès des infirmières qui me confirmèrent ma pensée : elles mettaient les médicaments sur la tablette de chambre de cette patiente connue comme inobservante, mais sans vérifier la prise…
Le hasard fit que c’est ce jour-là où je récupérai un dosage demandé par mon co-interne : l’hydroxychloroquinémie. C’était une idée complètement tordue, donc fameuse… puisqu’elle revint négative. Niet, nada. Zéro. Que dalle. Rien.
La demie-vie de l’hydroxychloroquine est de 45 jours environ, ce qui voulait dire que sur les 225 derniers jours – soit les 7 derniers mois – elle n’avait pas pris un seul comprimé. Même lorsqu’elle était en sueurs profuses, au fond de son lit, dans un état qui inquiétait tout le service, elle réussissait à avoir la force de ne pas prendre et de cacher son médicament. (Et bien sûr, on a vérifié : pas de problème d’absorption intestinale du médicament…)
Alors, je ne sais pas. Je me dis qu’un jour, lorsqu’on modernisera les chambres, on trouvera dans le mur de celle-ci de quoi ouvrir une nouvelle pharmacie. Peut-être qu’ils sont au pied de la fenêtre, ou dans les canalisations de l’hôpital.
Toujours est-il qu’avec cette patiente, j’aurai appris quelque chose…



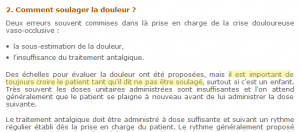


La gagnante est terrifiante. Je peine à la comprendre, à vrai dire. « Plutôt crever que de prendre ces médocs » ?
Eh ben. Pour vivre honnêtes, restez en bonne santé.
C’était un article sympa. Et tant que tu ne donnes pas de noms tu n’es pas rayé de l’ordre, c’est ça ? 😀
N’est-ce pas 😀
Merci. Les problèmes cités, notamment ceux d’observance, restent quand même fréquents, et les patients ne sont pas vraiment reconnaissables (sauf éventuellement le 2ème, mais de toute façon, je le vois assez mal porter plainte :D)
En plus, j’ai modifié certains petits éléments. Après tout… tout le m… enfin, t’as compris 😉
Tu sais qu’il suffit de trouver un seul exemple de personne n’ayant pas encore trouvé l’occas… n’ayant jamais voulu mentir à son médecin pour contrer ? Hein ? Tu le sais, ça ?
Oui. Mais tout le monde ment… à un moment 😉 Ce n’est pas tout le temps non plus ^^ Et ce n’est pas forcément des gros mensonges, parfois juste des omissions…
Ahahaha merci pour cet article j’ai bien ri en rentrant de conf ! 😀
N’empêche, plus j’avance dans mes études et plus je me dis qu’effectivement : tout le monde ment mais un vrai gros menteur pathologique énorme j’ai pas encore eu ^^
Ravi d’égayer ton tour de printemps 😀
Pour le gros menteur, ça viendra 😉
Je suis même sûr que tu en as déjà croisé sans le savoir, si on en croit les chiffres sur l’inobservance (souvent estimée entre 30-60%, selon la façon dont c’est étudié – par nombre de médicament pris ou arrêt définitif…) La page 10 de cette thèse est assez intéressante : http://www.sfmg.org/data/generateur/generateur_fiche/729/fichier_these_kanagarajah_1406201275b35.pdf
Ah oui si on compte ceux qui m’ont menti sans que je m’en rende compte bon j’avoue j’ai quand même du en croiser quelques uns ^^
Oui je me dis que ça viendra bien un jour je suis encore qu’un « bébé-docteur » comme me l’a dit une chef un jour ^^
Ahah ^^ « Bébé-docteur », on me l’a dit pour la première fois à mon stage post-P1… et pour la dernière fois il y a 2 semaines je crois 😉
J’ai bien ri mais franchement j’arrive pas à comprendre la patiente n°1 : sérieux, quand on est si mal en point, pourquoi refuser de prendre ce qui pourrait nous faire aller mieux ? Hallucinant !
Sinon, moi j’ai déjà eu le droit au grand classique :
« vous avez bu un peu hier juste avant de faire cette chute ?
– Oh un tout petit peu, normal quoi
– Bon je vais vous faire souffler pour savoir combien vous avez »
Résultat : 1g.L de sang le lendemain. Autrement dit, on a pas la même notion de ce qui est « normal »…